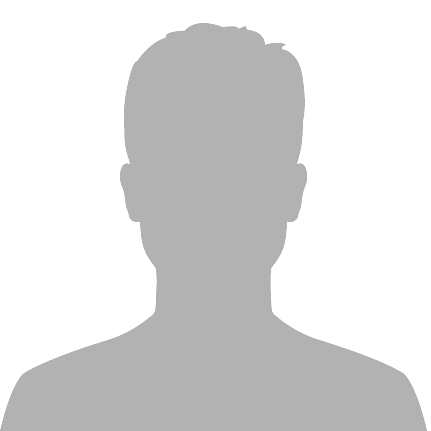La question particulière de la donnée
Dans notre utilisation d’internet, de sites commerçants, des emails ou de logiciels, nous faisons en effet naitre une profusion de données. Pour Mathieu Fontaine, « elles ont trois typologies. D’abord la donnée personnelle, pour laquelle il n’y a aucune ambiguïté : les textes européens en donne une définition, reprise par la loi Informatique et Liberté. Mais elle est très large et peu utile en matière juridique, puisqu’il s’agit de ‘tout élément d’identification de la personne’. Il y a ensuite les données pouvant être analysées comme du patrimoine concret, puis les données qui se trouvent entre la donnée personnelle et la donnée purement patrimoniale. » En exemple de donnée à la marge : le bitcoin, qui présente pour le notaire « un problème de qualification juridique ». « Si l’on a une réflexion purement citoyenne, le bitcoin est une monnaie : qu’elle soit virtuelle ou concrète, c’est donc un élément de l’actif. Mais si on le rapporte à la problématique numérique, c’est une clé cryptographique. Si l’on va plus loin, il s’agit d’une donnée personnelle, car elle est attachée à la personne détenteur de cette clé, sans autre contrôle ou moyen d’identification que la possession de cet élément numérique. Si c’est une donnée personnelle, elle n’est pas transmissible, sauf pour les besoins de la succession. Et malheureusement, nous aurons du mal à en avoir connaissance. » Difficile de concevoir qu’un portefeuille de bitcoins, compte tenu du potentiel financier qu’il représente – l’avenir nous dira s’il perdurera – ne puisse pas se transmettre à ses héritiers. D’autant que le statut de la donnée personnelle est, lui, bien déterminé : étant un élément de la personne, elle restera hors de tout commerce, et le particulier n’aura jamais la possibilité d’en retirer un quelconque bénéfice.
Elle a cependant de la valeur, pour les entreprises, lorsqu’elle est anonymisée. « Ce n’est pas votre nom que l’on va vendre, mais vos préférences de consommation, vos habitudes alimentaires, par rapport à votre sexe, à votre âge,… précise Mathieu Fontaine. Ce sont ces éléments-là qui intéressent le marché. C’est donc anonymisées et prises dans leur volume qu’elles prennent une valeur réelle. » Les entreprises doivent prendre conscience que ce nouvel élément numérique peut constituer un avantage conséquent, à faire valoir dans leur patrimoine. A condition de mettre en place les bonnes protections juridiques. « La donnée en elle-même ne se protège pas, explique Frédéric Auclair, chargé d’affaire à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). Vous pouvez en revanche protéger le fait de recouper, rassembler, vérifier les données et les mettre à disposition à travers une base de données, par exemple au titre du droit d’auteur, pour sa structuration et son apparence. Vous avez aussi le droit sui generis du producteur de base de données. Il permet à celui qui en est à l’origine de protéger ses investissements, pour empêcher l’extraction, sans son consentement, soit d’éléments importants d’un point de vue qualitatif ou quantitatif, soit une réutilisation répétée d’éléments incorporés dans la base. Mais l’analyse rapide en temps réel d’une grande masse de données (big data) ne donne pas prise à une protection au titre de la propriété intellectuelle. A mon sens, cela relève plutôt du secret des affaires. »
Dématérialisation : quelles conséquences ?
L’autre conséquence du numérique est la dématérialisation de très nombreux éléments qui avaient jusqu’ici une existence physique. C’est notamment le cas, du côté des entreprises, pour tous les éléments qui touchent à la propriété intellectuelle. « Le côté immatériel du numérique peut poser des difficultés car la protection de la propriété intellectuelle a eu l’habitude de porter sur des objets tangibles, avec des outils issus pour la plupart du siècle dernier » confirme Frédéric Auclair. Ainsi, il est encore nécessaire de sensibiliser les jeunes entreprises – start-up ou TPE/PME – sur l’importance de protéger tous les éléments qui relèveraient de cette protection, y compris pour des services entièrement numériques. « La propriété intellectuelle s’adapte aussi à ces problématiques. Si vous proposez par exemple du software de service, vous avez toujours besoin de vous faire connaître de vos clients : vous allez donc utiliser un signe distinctif, comme une marque. En étant uniquement sur des services dématérialisés, vous allez avoir au minimum un site internet pour toucher votre clientèle. Là encore, l’apparence de ce site pourra être protégé par le biais d’un dessin et modèle. Pour toutes les applications, sur smartphone ou en ligne, il peut y avoir une protection par le biais des brevets et des inventions mises en œuvre par ordinateur. »
Ce besoin de pédagogie ne vient pas que du numérique. D’après Frédéric Auclair, « la valorisation de la propriété intellectuelle a toujours été un petit peu plus complexe que celle d’un immeuble ou d’un outil industriel. » Pourtant, les titres de propriété industrielle sont des atouts de poids pour les petites structures. Une étude américaine [1] démontre ainsi que la détention d’un brevet augmente les chances des start-up de trouver un investisseur (+47%), de trouver un prêt (+76%), et de lever des fonds lors d’une entrée en bourse (+100%). Il est donc judicieux de valoriser les composantes numériques de son activité, et d’accompagner sa stratégie de protection – mission remplie par l’INPI, notamment en proposant de plus en plus de services aux start-up, ou en appliquant une réduction de 50% sur les dépôts de brevets des petites entreprises.
Et du côté des particuliers ? On peut notamment penser aux biens culturels, qui aujourd’hui se consomment de façon numérique. Musique, livres, films,… Ceux-ci pouvaient constituer des collections pour leurs propriétaires. Quelle serait aujourd’hui la valeur d’une collection de disques dématérialisée ? Du manuscrit d’un écrivain sous forme de document Word ? Comme le précise Mathieu Fontaine, « la valeur ne change pas, qu’il s’agisse d’un support numérique ou physique. Les déterminations de l’évaluation restent les mêmes. » En revanche, la dématérialisation fait naitre de nouveaux risques. D’une part, « le fait qu’elle soit numérisée ne fait-il pas craindre un accaparement de l’œuvre par un plus grand monde ? Si les personnes qui utilisent l’outil numérique pour créer ne sont pas sensibilisées à la protection des œuvres d’art, il faut craindre que quelqu’un d’autre s’en empare - parfois même, selon les contrats d’utilisation, l’hébergeur lui-même. Les personnes qui ont des contenus numériques à forte valeur doivent impérativement prendre conseil pour être accompagnées dans cette démarche intellectuelle de protection. » D’autre part, la tentation de dissimuler un élément numérisé de son patrimoine, pour le soustraire à la fiscalité applicable. « J’ai récemment eu le cas d’un écrivain qui possédait un manuscrit et qui avait reçu le conseil de le garder de façon numérique, pour qu’il ne soit pas connu et reste donc hors succession, explique Mathieu Fontaine. Hormis le fait qu’il s’agit d’un recel d’héritage, s’il n’est pas déclaré, ce bien ne suivra pas les règles légales de règlement de la succession. Le risque est alors que ce document soit récupéré par quelqu’un qui n’en était pas l’héritier, ou qui n’était pas héritier pour la totalité de la succession, créant alors un conflit très important a posteriori. Il faut donc absolument que ces éléments soient traités par le droit comme un élément classique. »
La question de la transmission de ces éléments numériques peut aussi être plus problématique que l’on ne pense. « Lorsqu’une personne achète et stocke de la musique, des films ou des livres sur son disque dur pour constituer une collection, on reste dans la notion de propriété. Mais aujourd’hui, nous avons plutôt tendance à utiliser des plateformes comme Deezer ou Spotify, qui sont soumises à des contrats de licence. Vous pouvez y créer une bibliothèque de musique très importante, qui constituerait un élément important de votre patrimoine affectif. Mais vous ne pourrez pas la transmettre comme des CD ou des 33 tours physiques. Le contrat de licence n’est qu’un abonnement qui vous donne le droit d’utiliser cette musique. Bien que vous l’ayez organisée en bibliothèque, elle ne vous appartient pas. » Même problématique en utilisant le cloud, dont les conditions d’utilisation, le plus souvent, ne prévoient pas la possibilité de transmettre à ses héritiers ses identifiants pour récupérer le contenu stocké. Pourtant, ces solutions de stockage sont plus sûres que les supports physiques, car les disques durs ou les clés USB subissent une dégradation dans le temps. Leur contenu, lors de la succession, pourrait finalement être illisible. Tous ces éléments doivent donc être pris en compte pour adopter la meilleure stratégie.
Des réponses juridiques qui se font attendre
Si les outils actuels permettent de répondre à un certain nombre de ces problématiques, de nouvelles dispositions juridiques vont donc être nécessaires pour pallier certains manques. Pour Mathieu Fontaine, « il est vraiment urgent de légiférer sur les qualifications juridiques, parce qu’aujourd’hui c’est le néant. Les décrets d’application de la loi Lemaire du 7 octobre 2016 ne sont toujours pas sortis. Aujourd’hui, nous faisons du bricolage, certes efficace, parce que nous traitons ces questions avec les outils que nous connaissons, comme le testament. Mais il y a beaucoup de points en suspend et qui sont pourtant essentiels, concernant les données, ou le recommandé électronique. Nous laissons les acteurs privés faire ce qu’ils veulent, ce qui permet d’avancer vite. En revanche, on se met en danger, car l’analyse de chacune de ces questions n’est pas toujours en faveur de la protection du particulier. »
Clarisse Andry
Article initialement publié dans le Journal du Village des Notaires n°68
Notes :
[1] « What is a patent Worth ? Evidence from the US patent lottery », National bureau of economic research (2017),Etude sur l’impact de la détention d’un brevet pour une start-up, basée sur l’analyse de près de 35 000 brevets délivrés aux Etats-Unis depuis 2001.